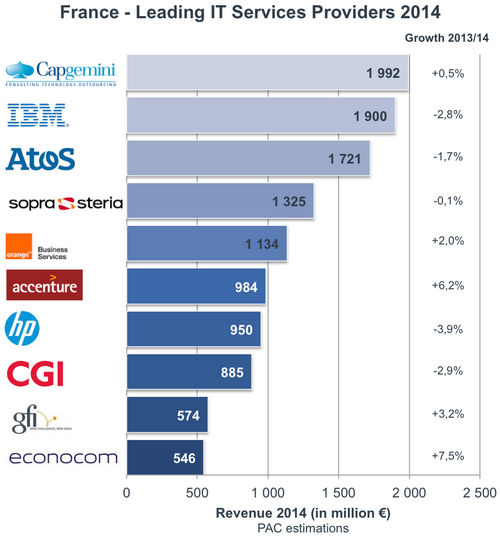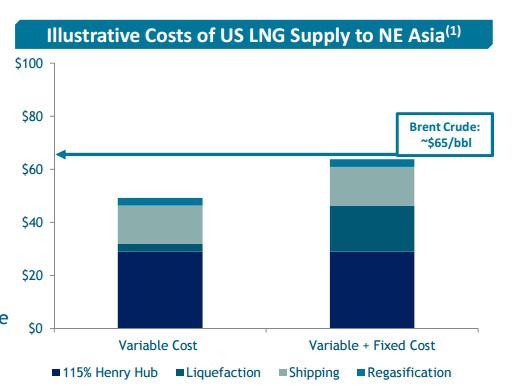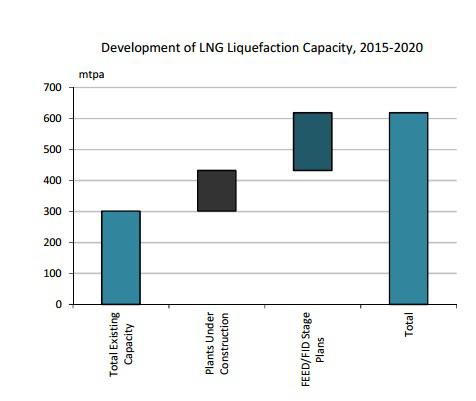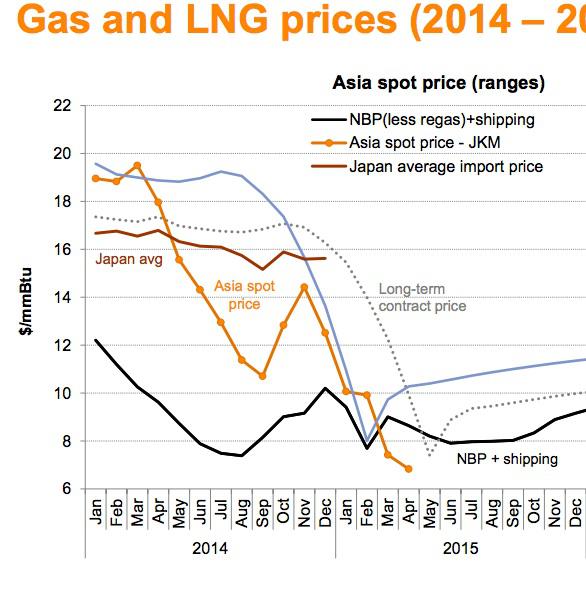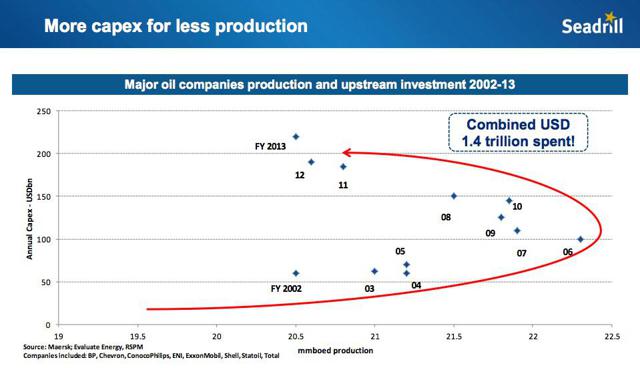Source : Assemblée nationale ~ Compte rendu de réunion de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
Mercredi 6 février 2013
Séance de 9 heures 30
Compte rendu n° 34
Présidence de M. Jean-Paul Chanteguet Président
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Marc Jancovici sur le changement climatique et la transition énergétique
– Information relative à la commission
Commission
du développement durable et de l’aménagement du territoire
La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a entendu M. Jean-Marc Jancovici sur le changement climatique et la transition énergétique.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. J’ai le plaisir d’accueillir M. Jean-Marc Jancovici pour sa première audition devant la commission du développement durable. Nous le recevons dans le cadre du débat sur la transition énergétique. Professeur à Mines ParisTech, expert reconnu sur les questions climatiques et énergétiques, auteur – et développeur principal – du bilan carbone pour le compte de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), vous avez créé en 2007, avec Alain Grandjean, le cabinet de conseil Carbone 4. Par ailleurs, vous siégez au Conseil économique, social et environnemental (CESE) et au comité de la veille écologique de la Fondation Nicolas-Hulot.
M. Jean-Marc Jancovici. Je vous remercie de prendre le temps de cet échange. Je n’ai certes jamais été auditionné par cette commission, mais j’ai participé à la mission de l’Assemblée nationale sur l’effet de serre que présidait, sous la législature précédente, M. Jean-Yves Le Déaut et dont Mme Nathalie Kosciusko-Morizet était rapporteure.
Sans énergie, le monde moderne n’existerait pas. La hausse du pouvoir d’achat, l’urbanisation, la tertiarisation, la mondialisation, le temps libre, les retraites, les études longues, les 35 heures et tous les acquis sociaux ont pu se développer grâce à l’énergie. Or, cette dernière se trouve dorénavant en quantité insuffisante pour que le travailleur français puisse maintenir son niveau de consommation. Que faire pour que cette situation ne dégénère pas en instabilité sociale forte ?
La production mondiale ne dépend que de l’énergie disponible. Toute contrainte sur le volume de l’énergie – et non sur son prix – se répercute sur le PIB. MM. Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont trompés : en annonçant la progression du pouvoir d’achat en 2007 pour le premier, en prédisant la reprise de la croissance en 2012 pour le second, ils pensaient que leur volonté pouvait prévaloir sur la physique. Dorénavant, l’Europe ne connaîtra plus de croissance : son cycle économique est appelé à reposer sur l’alternance d’une année de récession suivie d’un faible rebond. La croissance continue ne reviendra plus, car l’approvisionnement énergétique de l’Europe est déjà restreint : le gaz et le pétrole fournissent les deux tiers de la consommation énergétique européenne. Ainsi, tout plan prévoyant de nouvelles dépenses financées par un surplus de croissance échouera. L’avenir doit être pensé dans un environnement sans croissance.
Dans un tel cadre, il convient de veiller au puissant effet d’éviction des dépenses inutiles : engager des dizaines milliards d’euros pour des panneaux photovoltaïques revient à se priver de financement pour des actions véritablement utiles. Les énergies fossiles sont trop abondantes pour sauver le climat, mais trop rares pour relancer l’économie européenne. Il va être difficile de convaincre les pays détenteurs de charbon de ne pas l’utiliser dans un contexte de stagnation économique. L’Allemagne a emprunté cette voie. La hiérarchie des mérites et des nuisances varie selon la finitude ou l’infinitude de la disponibilité des ressources, puisque le poids des contraintes diffère en fonction de la source d’énergie.
Les modèles macroéconomiques d’aujourd’hui bouclent leurs équations par les prix et reposent sur des élasticités constantes entre prix et volumes. Ils sont devenus inopérants et n’ont pas permis d’anticiper la crise de 2007. Portons notre attention sur les volumes et non sur les prix ! Pour le pétrole, par exemple, l’élasticité entre prix et volume n’existe plus ; il n’est plus possible de déduire la quantité de pétrole produite à partir de son prix. Et c’est bien la quantité qui importe pour l’économie, non le prix.
En revanche, le pétrole nécessaire à la création d’un euro de PIB décroît en volume. De même, la part de l’énergie dans le budget des ménages diminue depuis quarante ans ; elle se situe à un niveau inférieur à celui qu’elle atteignait avant le premier choc pétrolier. De plus en plus de pétrole, de gaz et de charbon sont extractibles. Mais en conclure que le progrès technique et des politiques courageuses permettraient d’atteindre n’importe quel but néglige le principe de réalité. L’énergie correspond à une grandeur physique qui caractérise le changement d’état d’un système. Ce processus obéit à des lois qui ne souffrent aucune exception. Ainsi, quand le monde change, l’énergie intervient. Là où l’économiste mesure la transformation de l’activité par une valeur ajoutée libellée en monnaie, le physicien évalue la quantité de kilowattheure nécessaire à cette mutation. De fait, il ne peut y avoir d’énergie propre, puisque l’énergie exige la transformation, alors que la propreté induit l’immuabilité. Il s’agit d’en user en permettant aux avantages de surpasser les inconvénients.
Une personne bien entraînée, capable de gravir le Mont-Blanc un jour sur deux, produit avec ses muscles environ 100 kilowattheures d’énergie mécanique par an. Si un individu était payé au SMIC pour accomplir cette formation d’énergie, le kilowattheure coûterait entre plusieurs centaines et quelques milliers d’euros. Les énergies fossiles ont permis de réduire ce prix. Un litre d’essence correspond environ à 10 kilowattheures, ce qui permet une énergie mécanique mille à dix mille fois moins chère que le coût du travail en Occident. En 1860, une personne disposait chaque année de 1 500 kilowattheures d’énergie – surtout thermique, charbon et bois – ; elle les utilisait pour le chauffage, la métallurgie, le bateau à vapeur et le train. Cette quantité n’a cessé d’augmenter pour atteindre 20 000 kilowattheures.
Dans cette énergie extraite de l’environnement, le charbon n’a jamais décru et toutes les nouvelles sources d’énergie – pétrole et gaz dans un premier temps – sont venues s’ajouter à l’existant sans le remplacer. Quant à l’éolien, au biogaz, au photovoltaïque et à la géothermie, leur poids est infinitésimal. Ainsi, même une baisse limitée du pétrole, du gaz ou du charbon sera très difficilement compensée par ces énergies nouvelles. Le charbon constitue le premier mode de production de l’électricité et les deux tiers de sa consommation se font en ce sens. Voilà pourquoi cette dernière n’a jamais diminué. Le pétrole, lui, sert avant tout pour les transports.
Pendant plus d’un siècle, la consommation énergétique de chacun a crû de 2,5 % par an afin de réaliser les infrastructures de transport, l’urbanisation, la mutation de l’agriculture, l’essor industriel et les systèmes sociaux. Depuis 1980, cette hausse s’est tarie ; elle ne résulte plus que du charbon et de la Chine. Les chocs pétroliers ont constitué une rupture radicale dans l’approvisionnement énergétique qui a, à son tour, engendré le chômage et l’endettement, problèmes qui n’existaient pas en 1974. Là encore, le problème ne réside pas dans le prix mais dans le volume.
Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui, chacun dispose d’une énergie équivalente à celle de 200 esclaves. Sans les énergies fossiles, nous aurions besoin de deux cents planètes sur lesquelles 7 milliards de personnes produiraient de l’énergie pour maintenir notre niveau de vie actuel. Nous pouvons nous consacrer aux affaires publiques uniquement parce que l’énergie a remplacé la force de nos muscles.
Ce progrès s’est accompagné d’une croissance démographique exponentielle. Au moment où l’humanité s’est sédentarisée, la population mondiale ne dépassait pas quelques millions d’habitants ; elle atteignait 500 millions de personnes au début de la révolution industrielle et dépasse maintenant les 7 milliards, progression fabuleuse en seulement huit générations.
La consommation globale d’énergie a explosé : entre 1945 et le premier choc pétrolier, la consommation d’énergie mondiale a crû, en moyenne, de 5 %. Ensuite, elle a décéléré et diminuera bientôt. Elle provient, pour une part s’élevant à 80 %, de combustibles fossiles, restes de vie ancienne – fougères du carbonifère pour le charbon, algues et planctons pour le gaz et le pétrole. Même l’électricité est massivement fossile : la production française actuelle se monte à 550 térawattheures, soit à peine moins que la consommation mondiale en 1945. La généralisation de l’électricité date donc véritablement de la seconde moitié du XXe siècle. En 1973, les combustibles fossiles représentaient les trois quarts de la production électrique ; cette part s’est réduite aux deux tiers en 2007. Au cours de cette période, c’est de très loin le charbon qui a connu la progression la plus soutenue. Actuellement, la Chine installe une centrale à charbon par semaine et des capacités de production de 150 à 200 gigawatts sont en construction – à rapporter avec la capacité totale de la France qui ne dépasse pas 100 gigawatts. Après le charbon, l’énergie ayant connu la plus forte hausse est le gaz. Viennent seulement ensuite l’hydroélectricité et le nucléaire.
Le bois fournit 10 % de l’énergie mondiale. Il n’est, dès à présent, plus totalement renouvelable, puisqu’une partie de cette énergie correspond à de la recherche de bois de feu autour des villes africaines qui engendre de la déforestation. L’hydroélectricité représente l’essentiel des capacités d’énergies renouvelables en construction dans le monde, loin devant l’éolien. Ce dernier, même compté en équivalent primaire, ne produit pas 1 % de l’énergie mondiale. Les agrocarburants ne dépassent pas 0,4 % : quand le monde absorbe 4 milliards de tonnes de pétrole, il ne consomme que 60 millions de tonnes d’agrocarburants. Pour élaborer leurs agrocarburants, les États-Unis utilisent 40 % de leur maïs – soit la même part que celle qu’ils destinent à l’alimentation animale. En Allemagne, certains producteurs insèrent leur maïs directement dans les méthaniseurs pour favoriser la fabrication de biogaz. Enfin, le photovoltaïque contribue pour 0,1 % à la production énergétique mondiale.
Une fois observé ce panorama, je tiens à préciser que le terme de « production » d’énergie est impropre. L’action de l’homme consiste en effet à extraire l’énergie dite primaire de l’environnement, avant de la transformer en énergie finale qu’il pourra consommer.
La France, comme ses voisins, consomme une énergie provenant de combustibles fossiles. Son électricité provient, en très grande partie, du nucléaire. Mais il est faux d’affirmer que toute l’énergie française est nucléaire. Cela ne peut se dire que de l’électricité. L’essentiel de l’usage de l’électricité n’est pas thermique, mais spécifique, à savoir qu’il sert à alimenter des appareils – réfrigérateurs, pompes, lave-linge, lave-vaisselle, ascenseurs – non producteurs de chaleur. Or limiter cette utilisation s’avère plus difficile que de restreindre le besoin de chaleur.
L’emploi d’énergies renouvelables en France répond à la même hiérarchie que celle constatée dans le monde : d’abord le bois, puis l’hydroélectricité, puis l’éolien et, enfin, le photovoltaïque. Ces deux dernières sources d’énergie satisfont respectivement 0,35 % et 0,07 % de la demande d’énergie.
L’énergie a modifié la structure des métiers. Il y a deux siècles, les deux tiers des Français étaient paysans et chacun nourrissait 0,5 personne en plus de lui-même. Avec l’énergie, l’agriculture a pu se mécaniser – un tracteur de 100 chevaux équivaut à environ 1 000 individus – et un agriculteur actuel assure l’alimentation de 50 personnes. Ces dernières ont pu effectuer d’autres tâches grâce à l’énergie, qui permet de transformer de nombreuses ressources présentes dans l’environnement comme des minerais, du bois ou des sols. Ainsi s’est développée l’industrie, activité de transformation des réserves naturelles. Dans tous les pays occidentaux, le choc pétrolier a tari la croissance énergétique globale, qui est devenue inférieure à la productivité du facteur travail, ce qui a entraîné le déclin de l’emploi industriel. La contribution des services à la productivité plus faible a, en revanche, poursuivi son essor. Parallèlement, le chômage s’est massifié. Il y a un siècle, les lois sur le travail avaient pour objet de réduire le travail des femmes et des enfants, comme le temps que devaient y consacrer les hommes. Avant 1974, le facteur limitant l’activité était le travail disponible ; c’est désormais l’énergie. Plus la consommation d’énergie par personne est grande, moins la part de l’emploi dans l’agriculture est élevée. L’énergie abondante a permis l’urbanisation. Que la ville puisse, en accueillant 80 % de la population, organiser un système socio-économique stable dans un environnement énergétique contraint apparaît douteux.
L’opinion courante veut que le développement des services entraîne une dématérialisation, moins consommatrice d’énergie. Or c’est l’inverse : l’augmentation de la part des services dans l’économie n’est possible qu’une fois les fonctions productives remplies par des machines énergivores. Je pressens d’ailleurs que la contrainte énergétique va entraîner une hausse du travail manuel et une baisse des activités de service.
Les échanges plus massifs et mieux organisés ont permis l’étalement de l’habitat. Lorsque les villes ont été construites avant la période de profusion énergétique, les centres sont denses. Mais lorsqu’elles sont récentes, il n’y a pas de centre-ville. Atlanta constitue un bon exemple de cette dernière catégorie.
L’approvisionnement en énergie des pays de l’OCDE a déjà commencé de décroître. À l’inverse, il progresse dans les pays émergents, notamment en Chine. Épisode inédit, le PIB des pays de l’OCDE a également cessé d’augmenter depuis 2007. Cette situation risque de perdurer, car elle découle d’un tarissement énergétique. La France connaît la même situation, alors que l’économie des pays émergents poursuit sa croissance.
À l’école, nous apprenons que le travail et le capital sont les deux facteurs de production. Si cette dernière ne s’avère pas assez élevée pour financer la protection sociale, on diminue le coût du travail et du capital pour les stimuler. Or cette politique ne répond plus : alors que l’Allemagne emprunte à coût négatif et que les chômeurs sont très nombreux, le PIB n’augmente plus. C’est bien la preuve que cette description de l’économie est erronée. En fait, l’économie est une machine à transformer des ressources naturelles gratuites, la formation de capital n’étant qu’une boucle interne au système. Le brevet qu’un industriel dépose aujourd’hui ne résulte que de la transformation – par le travail – de ressources déjà existantes. Le goulet d’étranglement pour l’approvisionnement en ressources énergétiques – quel qu’en soit leur prix – induit mécaniquement un gel de la production. Le prix reste un élément significatif de l’équation économique tant qu’il n’y a pas de problème de quantité. Dans la pêche, le bateau représente le capital, le marin incarne le facteur travail, l’énergie provient du carburant mis dans le bateau et le PIB correspond à la valeur des poissons pêchés : si le diesel ou les ressources halieutiques disparaissent, la pêche et la production deviennent impossibles. Aujourd’hui, le niveau de notre activité économique est significatif du stock de ressources naturelles à transformer : il convient de surveiller attentivement ce dernier.
Depuis 1965, la consommation d’énergie et le PIB varient dans le monde de manière strictement parallèle. « Dis-moi combien d’énergie tu consommes et je te dirai quel est ton PIB » : telle pourrait être, simplement énoncée, la règle qui régit nos économies. En revanche, la variation du prix du baril et le PIB ne connaissent pas la même identité d’évolution. Lorsque le prix du baril augmente, un transfert de rente s’opère et la France s’endette au bénéfice de l’Arabie saoudite, mais rien ne change au niveau global. Vouloir régler le problème énergétique en attendant que les prix croissent fortement, revient à souhaiter une progression des revenus des pays producteurs d’hydrocarbures. Ainsi, la facture pétrolière et gazière de l’Europe a décuplé au cours de la dernière décennie. Cela a engendré un déficit commercial structurel qui s’est traduit par une augmentation de l’endettement. Cette situation se constate aussi bien dans les pays latins que dans les pays nordiques – y compris l’Allemagne. Il ne s’agit pas ici d’une question de couleur politique, mais d’un sujet de physique structurelle qui évolue à l’échelle du demi-siècle.
Le PIB par habitant est strictement égal au produit de l’énergie disponible par habitant et de l’efficacité énergétique, que l’on définit par l’augmentation du PIB induite par la création d’un kilowattheure d’énergie. La croissance du PIB par habitant résulte du produit de la variation de ces deux facteurs. La croissance de l’énergie mondiale s’établissait à 2,5 % par personne et par an avant 1980 et à 0,4 % depuis lors ; l’efficacité énergétique de l’économie a connu une croissance mondiale annuelle moyenne légèrement inférieure à 1 % depuis 1970. Pour que la règle que je viens d’énoncer soit juste, le PIB par habitant aurait dû croître de 3 % avant 1980 et de 1 % maintenant. Les chiffres de la Banque mondiale le confirment. Je suis donc en accord avec M. Vittori, éditorialiste aux Échos, lorsqu’il écrit que les lois de finances doivent dorénavant reposer sur une croissance économique nulle. Ce n’est pas agréable, mais mieux vaut prendre la réalité en compte plutôt que d’élaborer des plans voués à échouer.
Dans la relation étroite entre la production mondiale de pétrole et l’évolution du PIB, c’est la baisse du volume du pétrole qui entraîne celle du PIB et non l’inverse. On ne consomme pas moins de pétrole parce que c’est la crise, mais c’est la crise parce qu’on a moins de pétrole. La production mondiale atteindra son pic dans environ cinq ans. Ensuite, la décélération est inéluctable. Chacun s’interroge pourtant sur le prix du pétrole, alors que la question ne réside pas dans son évolution. La consommation de pétrole par l’Europe s’est réduite de 10 % depuis 2006 – repli amorcé avant le Grenelle de l’environnement – et cette tendance se poursuivra.
S’agissant du gaz, une projection réalisée par Total montre une production mondiale qui plafonne à partir de 2025, nonobstant le développement des gaz non conventionnels dont l’extraction sur le territoire français serait, de toute façon, difficile. L’approvisionnement gazier de l’Europe a cessé de croître lorsque les gisements de la mer du Nord – qui représentent 60 % de la consommation – ont atteint leur pic. Il est douteux que le nucléaire puisse être – même partiellement – remplacé par du gaz dans l’Union européenne.
Si l’on attribue la totalité des émissions de gaz à effet de serre aux citoyens et qu’on les inclut dans la fabrication des produits et services, les Français consomment, en moyenne annuelle, quelques centaines de kilos de CO2 pour la construction de leurs logements, deux tonnes de CO2 pour le chauffage de ces maisons, deux tonnes et demie pour l’alimentation – dont la moitié est due aux viandes et aux laitages –, deux tonnes et demie pour l’achat des biens manufacturés, deux tonnes pour le déplacement de personnes dans leur sphère privée et deux tonnes pour les services publics et privés – l’école, l’hôpital et l’armée d’une part, les banques, les coiffeurs, les opérateurs de téléphonie, entre autres, d’autre part. La fabrication de l’électronique destinée aux particuliers représente un tiers de l’empreinte carbone des achats de produits manufacturés ; deux tiers de la progression de 10 % de cette empreinte constatée entre 1990 et 2010 sont dus à l’électronique grand public : les technologies de l’information n’induisent aucune dématérialisation, ils ont créé des usages sans en supprimer d’autres. Dans les transports, l’avion a connu la plus forte croissance entre 1990 et 2010 ; or son utilisation est concentrée sur les deux premiers déciles de la population : créer un nouvel aéroport revient à construire une infrastructure pour riches.
Les émissions de gaz à effet de serre et l’usage de l’énergie fossile sont présents dans toutes nos activités. Le changement climatique ne peut donc être évité en contraignant une petite fraction de la population pour le bénéfice du plus grand nombre ; il ne peut l’être que par un effort de tous. Afin d’accompagner un tel effort collectif, il convient de développer une vision – un projet « sexy ». Sans vision, c’est le chaos qui règlera la situation. Voilà où vous entrez en scène, mesdames et messieurs les députés, et où je cesse de parler.
M. Arnaud Leroy. Monsieur Jancovici, je dois vous avouer que je comptais consacrer mon intervention au changement climatique, car vous aviez été présenté comme climatologue. Hélas, vous n’en avez pas dit un mot. En outre, comme vous êtes ingénieur, vous devriez nous proposer des solutions que j’ai cherchées en vain dans votre présentation.
Je suis d’accord avec vous pour affirmer la nécessité d’un effort commun. Encore faut-il préciser qu’il ne concerne pas que les Français, mais l’ensemble des habitants de la planète ! Je vous rejoins également sur l’exigence qui s’impose aux responsables politiques de tracer une vision et un plan pédagogique qui soit à son service.
Les précaires énergétiques existent bel et bien ! Après avoir discuté avec bon nombre de députés britanniques, allemands, estoniens et danois, je peux vous assurer que la situation des fuel poorscrée un véritable problème social qui se situe, notamment, au cœur de l’actuelle campagne électorale en Allemagne. Le poste de la facture énergétique dans les dépenses n’a peut-être jamais été aussi faible statistiquement, mais les ménages ressentent fort différemment la situation et nier ce sentiment revient à faire peu de cas de la démocratie.
Mme Christiana Figueres, secrétaire générale de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, souhaiterait que les autorités locales et les parlements nationaux s’impliquent davantage dans la mise en place du plan post 2015. La France a fait le choix de se rendre disponible pour accueillir la prochaine conférence des parties – dite COP 21 – en 2015. Cette candidature s’inscrit dans le cadre de la très forte ambition de notre gouvernement en la matière ; ainsi, M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, considère la diplomatie climatique comme un axe prioritaire de notre action extérieure. Comment enrichir et accompagner notre réflexion sur le sujet dans les deux ans qui viennent ? Quelles sont les pistes que vous pourriez proposer pour répondre au défi – que vous avez exposé de manière percutante – de la diminution de la disponibilité de l’énergie ?
Je vous trouve trop critique sur les énergies renouvelables, assez silencieux sur votre rapport au nucléaire et très peu prolixe sur l’efficacité énergétique. Mes collègues du groupe SRC, ravis de vous accueillir, vous interrogeront sûrement là-dessus.
M. Martial Saddier. Vous exposez vos travaux avec brio, et il faut au moins vous reconnaître le mérite de la logique. Les députés UMP sont d’accord avec vous sur l’urgence de l’enjeu pour la société ; le Grenelle 1 et le Grenelle 2, qui permettaient d’associer tout le monde, devaient d’ailleurs servir à établir du consensus, donc à éviter la démagogie et le populisme. Le président Nicolas Sarkozy n’en a pas été remercié, il est vrai, mais vous n’êtes pas plus tendre avec le président François Hollande…
Aux États-Unis, la question énergétique a été débattue durant la récente campagne électorale : comment analysez-vous ce débat ?
Que pensez-vous des potentielles réserves nouvelles d’énergies fossiles ? Que pensez-vous de la décision prise par l’actuel Président de la République de diminuer la part du nucléaire dans notre production énergétique, et de la décision de fermer la centrale de Fessenheim ?
M. Yannick Favennec. Merci pour cette présentation décoiffante. Lors de la conférence de Doha, les grandes puissances ont rivalisé d’inertie. La France, elle, n’a pas à rougir de son bilan en matière de gaz à effet de serre, notamment grâce au Grenelle de l’environnement ; une étude allemande récente nous place parmi les meilleurs élèves de la classe, ce qui doit nous amener à prendre le leadership. Mais où est aujourd’hui le volontarisme français ? La voix de la France semble s’être éteinte, au point que nous avons cédé sur des avancées que nous avions pourtant portées – je pense au fonds vert de la conférence de Copenhague qui devait mobiliser 100 milliards d’euros à l’horizon 2020, aux aides destinées aux pays qui seront les premières victimes du réchauffement climatique, à la taxe carbone aux frontières de l’Europe…
Quel est votre sentiment sur Doha et sur la position française ? Quel peut être le rôle de la France en ce domaine, en Europe comme lors des prochains sommets internationaux ?
Que pensez-vous de la réduction de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique français ? Les énergies renouvelables permettront-elles de compenser cette baisse ? Cette réduction est-elle compatible avec nos objectifs en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ?
M. Denis Baupin. Merci pour cet exposé provocateur ! Sur l’essentiel, nous sommes d’accord : nous traversons une crise structurelle, et l’énergie est au cœur de cette crise ; il est urgent de donner un prix au carbone, à l’épuisement des ressources pétrolières. Mais nous avons un désaccord majeur sur le nucléaire. Vous n’avez parlé ni de Tchernobyl, ni de Fukushima : si l’on veut prendre en compte le risque d’un accident nucléaire, il faut refaire tous les calculs, et donner aussi un prix au risque d’accident nucléaire.
Il faut donc commencer par réécrire les équations économiques et énergétiques. Mais que faire de ces constats ? Nous ne pouvons pas continuer à consommer de l’énergie comme avant, surtout avec une population croissante ! Pour l’Agence internationale de l’énergie (AIE), fondée à l’OCDE, la priorité doit être aujourd’hui d’aller à 77 % vers une plus grande sobriété et à 19 % vers les énergies renouvelables.
Je note d’ailleurs au passage que les États-Unis ont installé en 2012 plus de puissance éolienne que de puissance en gaz, et qu’il existe 1 662 éoliennes off-shore en Europe, dont aucune en France. Notre retard est donc conséquent.
Il faut aussi, vous avez raison, réfléchir sur notre alimentation, en particulier carnée, sur la mobilité, sur les bâtiments et leur consommation énergétique… Le ménage allemand, qui n’est pas moins doté en appareils électroménagers que le ménage français, consomme 20 % d’électricité spécifique de moins que le ménage français – sans même compter le chauffage électrique. Nous disposons donc de marges de progression très importantes.
Nous devons investir dans les secteurs les plus intensifs en emploi : rénovation thermique des bâtiments, transports collectifs, énergies renouvelables…
Ce débat est particulièrement utile. Nous avons, c’est vrai, besoin d’une vraie vision : le groupe écologiste pense que l’on peut sur ces sujets porter un discours positif sur la transition énergétique comme réponse à la crise.
M. Olivier Falorni. Voilà un exposé qui bouscule les certitudes, ce qui est toujours utile !
J’ai lu dans vos articles que vous privilégiez la « décarbonisation » des bâtiments, puis de l’industrie lourde et enfin des véhicules. Je vous rejoins sur ce point. Mais que devient alors l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production énergétique française – cap fixé pour 2025 par la Conférence environnementale ? Comment peut-on promouvoir le véhicule électrique et la pompe à chaleur tout en réduisant la part du nucléaire, sans favoriser l’exploitation de nouveaux gisements de gaz ou la production de biocarburants ?
Pourriez-vous nous éclairer sur la sortie du tout-pétrole ? Dans les grandes villes, le taux de motorisation diminue, mais c’est l’inverse à la campagne comme dans les villes petites ou moyennes, où l’automobile demeure indispensable.
Les biocarburants de troisième génération, produits à partir d’algues microscopiques riches en lipides qui peuvent accumuler entre 60 % et 90 % de leur poids en acides gras, ce qui pourrait laisser espérer une production annuelle d’une trentaine de tonnes d’huile par hectare, peuvent-ils constituer une réponse adaptée ? Le rendement du colza est, à titre de comparaison, trente fois inférieur.
La production de pétrole décroîtra dès 2020, et la production européenne diminue déjà. Le gaz de schiste ne pourrait-il pas diminuer notre dépendance vis-à-vis du pétrole ? Le retour d’expérience américain est, on le sait, mauvais pour l’environnement, mais d’autres formes d’exploitation pourraient remplacer la fracturation hydraulique. Que pensez-vous des recherches menées pour substituer à l’eau du GPL voire du gaz carbonique ? N’existe-t-il pas une exploitation écologique des hydrocarbures ? L’extraction du gaz de houille, contrairement au gaz de schiste, peut s’opérer sans recourir à la fracturation hydraulique.
Enfin, le Centre d’analyse stratégique a rendu en 2012 un rapport intitulé Énergies 2050, qui propose quatre scénarios d’évolution de la politique énergétique française, notamment en ce qui concerne le nucléaire, auquel je crois comprendre que vous êtes attaché. Quelle trajectoire devrions-nous suivre pour répondre aux exigences de la décarbonisation ? Devons-nous prendre en considération le développement des pompes à chaleur et des véhicules électriques, qui impliquent par ailleurs une évolution du réseau de distribution d’électricité intelligent ?
Le Danemark fait figure de bon élève en la matière, avec des objectifs très ambitieux. Est-ce la voie à suivre ?
M. Patrice Carvalho. Eh bien voilà qui décoiffe ! Ceux qui me connaissent savent que je ne pratique pas non plus la langue de bois, donc je le dis : c’était parfois un peu hard ! Je connaissais Marx, et son explication de la société capitaliste qui nous mène à la ruine, maintenant je connais aussi Jancovici (Sourires).
Vous parlez de risques d’explosion sociale, mais aujourd’hui, beaucoup de gens n’arrivent pas à se loger, se chauffer, se soigner… Pour satisfaire ces besoins, nous avons besoin de croissance économique. Sinon, ne risquons-nous pas le retour à la bougie et à l’âge où nos grands-mères faisaient la lessive au lavoir ?
Sur le rôle des médias, je suis entièrement d’accord avec vous : même à LCP, c’est vraiment la pensée unique ! (Sourires)
Vous ne parlez pas de la recherche : nous sommes peut-être à l’âge de pierre en matière d’énergie, ne perdons pas espoir dans le progrès scientifique.
Votre message est fort, mais quelles sont les perspectives d’avenir ? Je vous l’avoue, j’ai craint un moment que vous ne lanciez un appel au suicide collectif !
M. Philippe Plisson. On ne peut que partager votre diagnostic, mais quelles solutions proposez-vous ? Ne devons-nous pas saisir l’opportunité de changer radicalement de modèle de développement, en remettant les énergies renouvelables que vous méprisez au cœur du dispositif ?
Que pensez-vous de l’exploitation des gaz de schiste ? Que pensez-vous des clathrates de méthane : épée de Damoclès climatique ou ressource énergétique potentielle ?
M. Jean-Marie Sermier. Votre constat est partagé par le plus grand nombre. Mais comment pouvons-nous aujourd’hui prendre des mesures à l’échelle nationale quand la Chine ouvre une centrale à charbon par semaine ? Quelle gouvernance mondiale pourrait permettre des avancées significatives ?
Chacun doit pouvoir se retrouver dans le grand projet d’avenir que vous appelez de vos vœux. Avons-nous le temps d’intéresser la population à cette réflexion ?
L’exploitation de l’hydrogène fatal vous paraît-elle présenter un intérêt ?
Mme Geneviève Gaillard. Je partage les grandes lignes de l’exposé, mais vous ne présentez pas de solutions. L’énergie la plus propre, c’est celle que l’on ne consomme pas : la France est-elle armée pour entrer dans la transition énergétique ? Avez-vous des propositions en matière de fiscalité énergétique, et en matière d’aménagement du territoire ?
M. Édouard Philippe. Merci pour cette présentation perturbatrice mais stimulante.
Il est temps, vous le dites, de prendre en considération des indicateurs de prélèvements sur les stocks : des économistes, des spécialistes de comptabilité nationale, mènent-ils des recherches en ce sens ?
Vous avez peu parlé des conséquences de ce système sur le climat ; vous avez montré une diminution de la ressource énergétique, mais vous n’avez pas évalué l’échelle de temps nécessaire pour mesurer les conséquences pour les émissions de gaz à effet de serre de la diminution de cette ressource énergétique.
Votre message me paraît un message d’espoir pour les politiques que nous sommes : c’est à nous d’inventer des réponses nouvelles à la réalité que vous décrivez. J’entends donc un message de prise de pouvoir des élus, et non de condamnation des élus.
M. Jacques Krabal. Vous semblez opposé aux hydrocarbures non conventionnels et peu confiant dans l’avenir des énergies renouvelables : pourquoi ?
Vous êtes si peu effrayé par le nucléaire que vous prétendez, dans l’un de vos livres, que l’accident de Tchernobyl n’aurait provoqué que quelques dizaines de morts, mais aucun surcroît de mortalité par cancer. Certaines études évaluent pourtant les morts de 5 000 à 80 000. Vos assertions paraissent aujourd’hui choquantes : les maintenez-vous ?
Mme Sylviane Alaux. Vous écrivez que le gaz de schiste est une « fausse bonne idée » : sur quelles études vous fondez-vous ? Certes, la méthode d’extraction aujourd’hui utilisée pose problème, mais ne devrions-nous pas surtout en chercher d’autres – ce que font certains pays ?
M. Jacques Kossowski. Vous êtes, à l’inverse du Gouvernement actuel, un ferme partisan du nucléaire civil. Pouvez-vous expliciter votre position ?
Mme Brigitte Allain. Vous avez souligné l’importance de l’alimentation dans nos émissions de gaz à effet de serre. L’étude prospective Afterres 2050 propose un scénario d’évolution possible : nourrir tous les habitants de notre planète impose des changements profonds, et donc l’adoption, de façon quasi-générale, de nouvelles pratiques agricoles et alimentaires. Qu’en pensez-vous ?
M. Serge Bardy. Quels sont les blocages, notamment institutionnels, qui rendent si difficile la lutte contre le changement climatique à l’échelle du monde ? Vous aviez proposé la nomination dans chaque cabinet de ministère et dans chaque direction générale européenne d’un conseiller technique au développement durable, et même la création d’une Cour du développement durable, qui serait une extension de la Cour des comptes. Pouvez-vous préciser cette proposition ?
Comment, en période de crise, augmenter fortement les tarifs de l’énergie sans diminuer brutalement le niveau de vie des Français, dont une grande partie est d’ores et déjà fragilisée ?
Comment concilier l’engagement n° 41 du Président de la République – baisser la part du nucléaire dans notre production énergétique – avec une diminution de nos émissions de CO2 ?
M. Jean-Pierre Vigier. Voilà un exposé qui décoiffe ! Si nous diminuons notre production d’énergie nucléaire, nous devrons utiliser d’autres moyens de production. Vous l’avez dit, l’éolien et le solaire seront bien loin d’y suffire. Avec le gaz, le charbon et le pétrole, nous dépendrons de l’étranger et nous polluerons beaucoup plus. Que faire alors ?
M. Charles-Ange Ginesy. Vous nous dites qu’il faut diminuer notre consommation d’énergies fossiles, mais que les énergies renouvelables ne représentent à peu près rien : en diminuant notre consommation, pourrons-nous éviter la décroissance ? Vous préconisez le vote d’un budget sans croissance ; mais, d’un point de vue économique, cela empêcherait notre société de rebondir.
Vous semblez enfin compter pour rien le progrès scientifique : je crois, moi, que la recherche représente une nouvelle espérance pour demain.
M. Christophe Priou. Quel avenir pour ce marin-pêcheur breton que vous évoquez ? Ce jeune pêcheur, en particulier, doit se loger, une fois revenu à terre, et souvent la pression démographique sur le littoral oblige à construire sur les terres agricoles… Quel urbanisme peut-on imaginer pour demain ?
M. Jean-Louis Bricout. Vous préconisez un nouvel urbanisme et un nouvel aménagement du territoire. Vous plaidez également pour que les collectivités territoriales s’acquittent d’une taxe carbone. Mais vous n’ignorez pas la situation financière difficile de ces collectivités : comment envisagez-vous la mise en place de cette taxe ? Plus généralement, quel rôle assignez-vous à l’État pour accompagner les collectivités territoriales ?
M. Michel Heinrich. Merci pour cet exposé dont je suis encore abasourdi. L’alternative pour vous, c’est la vision ou le chaos. Pensez-vous que nous aurons cette vision ? La taxe carbone dans un seul pays vous paraît-elle pouvoir constituer un gadget temporairement utile ?
Mme Sophie Rohfritsch. Votre exposé était passionnant : plutôt que de transition énergétique, ne faudrait-il pas parler de transition tout court ? Le coût du capital n’ayant jamais été si bas, ne peut-on d’ailleurs pas voir là l’opportunité d’investir massivement – dans les énergies renouvelables, ou peut-être dans le nucléaire ?
Il paraît impossible d’agir à l’échelle mondiale. Quelle serait alors la bonne échelle de réflexion pour un élu – le petit territoire, la France, l’Europe ?
Vous avez proposé la création d’une mission parlementaire sur les travaux de l’AIE et sur la meilleure façon de prévoir les quantités d’énergie, notamment fossile, dont nous disposerons. Monsieur le président, ne pourrait-on pas envisager la création d’une telle mission ?
M. Yves Albarello. Ma question sera provocatrice : en persistant à vouloir améliorer notre propre bilan carbone, quand la Chine ouvre une centrale à charbon par semaine, ne sommes-nous pas dans l’erreur ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle que la Chine est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables.
M. David Douillet. Comment envisagez-vous la transition énergétique globale ? La France est-elle en retard ?
M. Alain Gest. Vous écouter est toujours un vrai bonheur, monsieur Jancovici. Vous estimez qu’il faudrait multiplier par deux, voire par trois, le prix des carburants, et vous vous opposez aux tarifs subventionnés sur le gaz et l’électricité. Quelle est votre position sur la vérité des prix de l’énergie ?
M. Jacques Alain Bénisti. Un séisme de magnitude 8 a frappé ce matin même les îles Fidji. Y a-t-il un lien de cause à effet entre le changement climatique et les mouvements géologiques de plus en plus fréquents que nous constatons ?
M. Jean-Marc Jancovici. Je ne pourrai bien sûr pas répondre à toutes les questions qui ont été posées ; je vous renvoie à mon site internet. Je prends la précaution de dire ici, comme je le fais souvent, que les malentendus vont se nicher dans ce qui n’a pas été dit : or le temps qui m’est imparti est limité.
Certains d’entre vous ont remarqué qu’il faut parler de transition tout court, d’un projet de société à long terme : il s’agit d’aller conquérir la Lune ! Pour cela, il faudra aller chercher les gens où ils sont : ils ne viendront pas d’eux-mêmes.
Plusieurs questions portaient sur les ressources et le gaz de schiste. Pour vous donner les ordres de grandeur, l’Europe consomme aujourd’hui 500 milliards de mètres cubes de gaz par an, dont 300 milliards viennent de la mer du Nord. On pourrait obtenir des gaz non conventionnels quelques dizaines de milliards de mètres cubes par an en Europe. La France consomme 50 milliards de mètres cubes par an, dont 30 pour le chauffage et 15 pour l’industrie. Si le seul souci, c’est de satisfaire les demandes des chimistes français, il suffit de conserver une consommation de 15 milliards de mètres cube par an et nous nous en sortirons : il faut seulement supprimer les 30 milliards du chauffage qui coûtent 6 milliards d’euros en importations par an ; cela se fait avec l’isolation et les pompes à chaleur.
Sortir le gaz et le fioul des usages thermiques dans le bâtiment est l’une des toutes premières priorités à fixer pour cette nouvelle conquête de la Lune. Il faudra demander des efforts à tout le monde, et l’effort partagé par tous n’est possible que si l’on propose un projet : dites à un astronaute qu’il va aller sur la Lune, il sera d’accord pour risquer sa vie. Cela, c’est votre rôle. Si vous ne proposez pas une vision exaltante à notre pays, n’essayez pas de demander des efforts : ça ne marchera pas !
Quant à l’argent nécessaire, on peut toujours trouver des « clopinettes pour bricoler », poser des rustines et boucher des trous ; ce n’est pas très exaltant. Mais si l’objectif est de conquérir la Lune, alors l’argent n’est plus le sujet. On le trouvera ! On a bien trouvé mille milliards pour les banques…
Le vrai sujet, c’est l’arbitrage : nous n’aurons pas d’argent pour tout – pour donner un travail à tout le monde, pour donner de l’espoir à tout le monde, et pour donner plus de consommation à tout le monde. Mais préserver la stabilité socio-économique de notre pays avec de l’espoir et un travail pour tous, on peut le faire.
D’autres questions portaient sur les négociations internationales et le rôle de la France. Je l’ai dit, l’énergie fossile, c’est le pouvoir d’achat et le niveau de vie ; dès lors, jamais des hauts fonctionnaires, si méritants soient-ils, ne pourront se réunir et décider ensemble d’un niveau rationnel de consommation des individus sur la planète. Cela ne peut tout simplement pas fonctionner. Ce qui pourrait fonctionner, c’est qu’une région du monde se lance dans ce projet avec résolution, massivement et de façon structurée. Or l’Europe, je vous l’ai montré, est dos au mur : notre choix doit donc être de nous lancer, de façon déterminée, dans la construction d’une économie de moins en moins liée aux combustibles fossiles. Cela sera notre conquête de la Lune, et cela nous occupera quarante ans car il faudra tout refaire : les villes, les réseaux de transport, les paysages agricoles…
Ce n’est pas une transition à 100 milliards d’euros, c’est une transition à 5 000 ou à 10 000 milliards. Et c’est une très bonne nouvelle : cela nous donne une colonne vertébrale, un projet qui exige un très large consensus politique – aussi large que sur la nécessité d’avoir des caisses de retraite. Il faudra que vos divergences s’expriment à la marge – un peu plus de marché ici ou un peu plus d’État là-bas… C’est une union nationale qu’il nous faut.
Beaucoup de questions portaient sur le nucléaire. Pour résumer ma position, je pense que c’est une bien meilleure idée qu’une mauvaise. Le nucléaire crée des inconvénients – je vous l’ai dit, l’énergie propre n’existe pas. Mais il évite globalement plus de problèmes qu’il n’en crée. On trouve aujourd’hui, même chez les Verts, des gens qui, en tête-à-tête, seraient prêts à classer le dossier nucléaire parmi les points de désaccords constatés que l’on peut mettre de côté…
M. Denis Baupin. Il faut les virer ! (Sourires)
M. Jean-Marc Jancovici. …non, il faut les écouter ! Le nucléaire est une question d’arbitrage. Sur la partie technique, sur le nombre de morts provoqués par Tchernobyl, sur les déchets, je vous renvoie à mon site où vous trouverez une avalanche de chiffres, les sources et les méthodes.
La question fondamentale des besoins a été posée. Il y a les faits et leur ressenti. Le second intéresse l’électeur et l’élu, mais le physicien se concentre sur les premiers. Tocqueville l’avait prévu : la démocratie nous rend « rouspéteurs » et perpétuellement insatisfaits. En France, on consomme 60 mégawattheures par personne chaque année, c’est-à-dire l’équivalent du travail de 600 esclaves ! L’espérance de vie a triplé en deux siècles. Alors qui est pauvre ? Votre question est centrale, si l’on s’intéresse au ressenti et à l’équité. Mais en termes de réalité physique, je répète que les citoyens modestes devront prendre leur part de l’effort. La seule façon de les convaincre, c’est de leur donner du boulot, de la fierté et des perspectives.
Sur la taxe carbone, les choses sont simples : elle taxe l’énergie tout en détaxant le travail. Ce n’est pas un impôt punitif, mais un guide. Elle donne de la visibilité.
Mon ambition consiste à soutirer de l’argent à des gens qui ne sont pas a priori volontaires pour réfléchir à leur avenir : les industriels. Que fait un industriel, ou un gestionnaire d’entreprise, quand il réfléchit à l’avenir ? Il cherche les certitudes. S’il n’est pas convaincu que l’énergie coûtera de plus en plus cher, il n’investira pas pour diminuer sa consommation. Or l’énergie fait marcher des systèmes extrêmement rigides : ce problème se résout par l’investissement. L’efficacité énergétique, c’est monstrueusement capitalistique : il faut changer les procédés industriels, les bâtiments, les infrastructures de transports et les bateaux. Pour investir, il faut de la visibilité, donc un prix à l’externalité. Sinon, les industriels resteront assis sur leur chaise.
C’est d’ailleurs la même chose pour les particuliers : regardez combien la différence de prix entre essence et gazole a déformé le parc automobile. Ces signaux jouent un rôle majeur à long terme. Évidemment, c’est la difficulté de votre mandat où vous êtes jugés sur des résultats à court terme, d’où la nécessité d’un consensus. Si l’on veut que la population et les milieux économiques adoptent cette vision à long terme, on doit être cohérent. Il faut hiérarchiser les problèmes. Si l’on considère qu’il faut d’abord se débarrasser des énergies fossiles et lutter contre le changement climatique, alors il faut privilégier tout ce qui agit en ce sens, nucléaire compris. Dire qu’on va diminuer notre production nucléaire de 50 % en 2025 revient à une illusion – ce chiffre est sorti d’ailleurs d’un chapeau, mais cela arrivait aussi avec Nicolas Sarkozy. Si nous décidons vraiment de mettre en place une société qui fonctionne avec beaucoup moins d’énergie fossile, alors le nucléaire devient secondaire. Rappelons que l’acceptation du nucléaire au Royaume-Uni a augmenté après l’accident de Fukushima.
M. Denis Baupin. Et en Iran ?
M. Jean-Marc Jancovici. Je ne suis vraiment pas partisan du nucléaire en Iran ! (Sourires)
La France a encore du poids en Europe. Si nous parvenons à entraîner le continent dans l’invention d’une économie qui permette de conserver des aspirations sociales et un espoir pour l’avenir avec moins de combustible fossile, alors nous arriverons peut-être à entraîner aussi le reste du monde. Voilà vingt ans que nous nous regardons tous en chiens de faïence parce que personne ne sait comment faire. Mais les premiers qui se lanceront emporteront le morceau ! L’Europe a une excellente raison d’agir, en dehors même du changement climatique : si nous continuons à suivre la ligne de pente, nous subirons, complètement désemparés, l’enchaînement des périodes de récession, et nous irons vers le chaos.
Je ne dis pas cela pour critiquer l’actuel Président de la République : je veux vous montrer les enjeux et les marges de manœuvre. Édouard Philippe l’a dit, cela doit vous stimuler et pas vous abattre. Mais le temps presse : il est urgent de se demander sérieusement comment construire un projet politique dans ce genre d’univers. Je veux bien vous y aider.
J’ai été taquin sur les énergies renouvelables, mais cela correspond aux faits. Si, à la suite du Grenelle de l’environnement, on avait décidé de généraliser les poêles à bois, j’aurais applaudi ; investir en revanche dans le photovoltaïque, c’était de la dernière stupidité. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, mais je suis contre la gestion d’un sujet sérieux par des méthodes sentimentales.
Prenons l’exemple suédois, pays remarquable en matière d’énergies renouvelables. La Suède jouit d’une réputation parfaitement écologique, alors qu’elle consomme autant d’énergie nucléaire par personne que la France, et deux fois plus d’électricité par personne – moitié hydraulique, moitié nucléaire. L’industrie lourde n’utilise quasiment pas de combustible fossile, essentiellement de l’électricité décarbonée et du bois. La consommation de gaz et de charbon y est quasi-nulle, et la totalité du chauffage est assurée par des réseaux de chaleur au bois. Mais il est vrai que le pays fait 350 000 kilomètres carrés, pour 9 millions d’habitants, et qu’il est couvert à 70 % de forêts.
La clé du succès pour les énergies renouvelables, c’est toujours beaucoup de montagnes ou beaucoup d’espaces arables. Les Européens devraient se pencher sur ce qui se passe dans le désert : beaucoup de soleil et peu de monde. Au lieu de dépenser 100 à 150 milliards d’euros de contribution au service public d’électricité (CSPE) pour déployer du photovoltaïque en France, on aurait bien mieux fait de monter un grand projet avec les Marocains et les Tunisiens – les Algériens, qui ont du gaz, n’auraient sans doute pas été intéressés. On aurait lancé une belle entreprise, et donné du boulot aux ouvriers français pour développer des technologies qui seront peut-être très utiles dans toute la bande tropicale à l’avenir.
Les Espagnols, qui boivent aujourd’hui une potion économique peu sympathique, auraient bien tort de ne pas chercher à exploiter les conditions climatiques de leur pays. Aller faire du solaire à concentration dans le sud de l’Espagne, c’est à mon avis beaucoup plus sérieux que de faire du photovoltaïque en France. Bref, je suis un grand partisan des énergies renouvelables, quand elles sont gérées avec des méthodes sérieuses.
Quant à l’éolien, il n’a pas en France beaucoup d’intérêt : il en a dans les pays qui souhaitent consommer moins de charbon. La diffusion massive de l’éolien impose en effet de disposer de moyens de stockage très important, ce qui porte le coût du mégawattheure entre 200 et 400 euros… Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, d’ailleurs : une hausse du prix de l’énergie, ce n’est pas grave si c’est de la rente redistribuée nationalement.
Enfin, vous verrez sur mon site que, lorsque vous déplacez une énergie produite nationalement – le nucléaire, par exemple – vers une autre énergie produite nationalement – l’éolien, par exemple –, vous ne créez globalement pas d’emploi si vous payez les gens de la même façon. Je sais que c’est perturbant, mais une simple règle de trois permet de le montrer.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci pour ce débat nourri qui sera, je l’espère, fructueux pour nos réflexions.
*
* *
Information relative à la commission
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je propose à la commission de désigner notre collègue Christophe Bouillon rapporteur sur la proposition de loi relative à la prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers (Sénat n° 272).
M. Christophe Bouillon est désigné rapporteur de ce texte.
——fpfp——
Membres présents ou excusés
Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
Réunion du mercredi 6 février 2013 à 9 h 45
Présents. – Mme Sylviane Alaux, M. Yves Albarello, Mme Brigitte Allain, M. Christian Assaf, M. Julien Aubert, M. Serge Bardy, M. Denis Baupin, Mme Catherine Beaubatie, M. Jacques Alain Bénisti, M. Philippe Bies, M. Florent Boudié, M. Christophe Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, Mme Sabine Buis, M. Vincent Burroni, M. Alain Calmette, M. Yann Capet, M. Patrice Carvalho, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Guillaume Chevrollier, M. Jean-François Copé, Mme Fanny Dombre Coste, M. David Douillet, Mme Françoise Dubois, M. Philippe Duron, Mme Sophie Errante, M. Olivier Falorni, M. Yannick Favennec, M. Jean-Christophe Fromantin, Mme Geneviève Gaillard, M. Alain Gest, M. Charles-Ange Ginesy, M. Michel Heinrich, M. Jacques Kossowski, M. Jacques Krabal, Mme Valérie Lacroute, M. Alain Leboeuf, Mme Viviane Le Dissez, M. Arnaud Leroy, M. Michel Lesage, M. Jean-Luc Moudenc, M. Bertrand Pancher, M. Rémi Pauvros, M. Edouard Philippe, M. Philippe Plisson, M. Christophe Priou, Mme Marie-Line Reynaud, Mme Sophie Rohfritsch, M. Martial Saddier, M. Jean-Marie Sermier, Mme Suzanne Tallard, M. Jean-Pierre Vigier
Excusés. – Mme Chantal Berthelot, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Florence Delaunay, M. Stéphane Demilly, M. Laurent Furst, M. Christian Jacob, M. François-Michel Lambert, M. Olivier Marleix, M. Philippe Martin, M. Philippe Noguès, Mme Catherine Quéré, M. Gilbert Sauvan, M. Gabriel Serville, M. Thierry Solère, M. Patrick Vignal